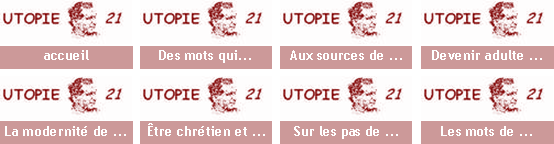|
devenir adulte dans la foi (Claude Bouchard)
À cette heure-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: « Qui est le plus grand dans le Royaume des cieux?» Appelant un enfant, il le plaça au milieu d’eux et dit: «En vérité, je vous le déclare, si vous ne changez pas et ne devenez comme les enfants, non, vous n’entrerez pas dans le Royaume des cieux. Celui-là donc qui se fera tout petit comme cet enfant, voilà le plus grand dans le Royaume des cieux. Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là, m’accueille moi-même. » (Mt 18, 1-5).
Un point de départ: la croissance dans la foi.
Le thème de la croissance dans la foi est omniprésent dans les spiritualités chrétiennes. L’idée de croissance implique la possibilité, voire la nécessité, d’un changement, d’une évolution de la foi. Elle signifie un apprentissage, un cheminement dans la foi. Ainsi, il apparaît assez clairement dans l’ensemble des traditions chrétiennes que la foi ne saurait être un acquis définitif et qu’elle s'accomode mal de la stagnation.
Ainsi, pour les croyants et croyantes, s’assurer d’une croissance dans la foi demeure une priorité. Evidemment, qui parle de cheminement et d’évolution, parle également de directions ou d’objectifs vers lesquels il nous faut tendre. De la même façon, celui ou celle qui parle de croissance cherche également des points de repère afin de mesurer les progrès, de décrire cette croissance.
Nous tenterons donc en ces quelques lignes de présenter un portrait de ce que pourrait représenter une foi adulte; c’est-à-dire de proposer des orientations et des points de repère qui nous permettent de mesurer notre propre croissance, de présenter un idéal de cheminement vers lequel tendre en tant qu'adultes croyants.
Une foi d’adulte, sur le modèle de celle d’un enfant?
Pour ce faire, nous rejetons dés le départ ce discours où l’on a trop souvent réduit la foi des «enfants de Dieu» à un modèle d’innocence, de pureté ou de perfection morale qui devrait servir pour les adultes, comme si la vie de l’adulte n’était qu’une quête pour retrouver cette innocence ou cette perfection «originelle» de l’enfant, pour retrouver une sorte de «paradis perdu» par l’adulte en quelque sorte perverti par la vie...
Nous nous faisons donc un devoir de laisser ce discours et ces concepts à ceux et celles qui les manient si bien. Pour nous la perfection et l’innocence du nouveau-né, si elle semble bien effective, ne représente pas un idéal à poursuivre. Bien d’autres défis attendent l’homme et la femme selon nous.
Une croissance dans la foi qui implique une tension,
Comment dire en peu de mots la tension existentielle qui devrait habiter toute démarche de foi aspirant à davantage de maturité? Tout simplement en affirmant qu’une démarche spirituelle est un cheminement qui se présente à la fois comme un accomplissement et un dépassement de l’être humain.
La croissance dans la foi vise donc l'accomplissement de l'être humain, en ce sens qu'elle vise la pleine réalisation de la personne afin d'actualiser ce potentiel de perfection que l'on retrouve au coeur de chaque être humain. Mais en même temps, elle vise la transformation de la personne, elle cherche le dépassement de l’être humain qui se rend compte finalement de ses limites, de son incapacité à rendre compte de toute la réalité.
La tension au sein de laquelle doit demeurer toute personne qui aspire à grandir dans la foi est celle qui existe entre la nécessité de s’accomplir soi-même, de se réaliser, de prendre réellement en charge son existence, bref d'être centré sur soi-même et sa propre croissance, et la nécessité de s’ouvrir à tout ce qui n’est pas soi, à tout ce qui nous dépasse, de s'abandonner à cette réalité que nous ne pouvons qu’entrevoir, et de découvrir ainsi que ce «je» qui nous préoccupe tant et qui doit continuer à nous préoccuper, existe en fonction d’une rencontre avec ce qui est «autre».
Vers une foi de plus en plus adulte.
Quels sont donc ces signes, ces points de repère qui nous permettent d’affirmer qu’une personne témoigne d’une foi de plus en plus mature? En fait, il s’agit de déterminer dans quelle(s) direction(s) le croyant ou la croyante peut évoluer, et cela à trois niveaux particuliers.
Sur le plan affectif, nous pouvons affirmer que la marque d’une foi de plus en plus adulte est qu’elle se présente comme de plus en plus libre et personnelle, le «je» étant au centre du cheminement, tout mi étant une démarche qui tend de plus en plus à l’abandon de confiant à Dieu, le «je» étant résolument ouvert à l'altérité de Dieu.
Sur le plan de l’agir, nous pouvons penser que la marque d’une foi de plus en plus empreinte de maturité se reconnaît au fait que la démarche de foi de la personne donne de plus en plus sens à son existence, lui permettant de clarifier son projet de vie, tout en lui donnant de plus en plus la capacité de marcher dans l'obscurité ou l’incertitude.
Sur le plan intellectuel, une foi adulte se mesure au fait qu’elle est de plus en plus éclairée, capable de s’articuler dans un discours et une réflexion; tout en étant de plus en plus ouverte à l'expression symbolique qui permet d’appréhender l'indicible et le mystère par-delà le discours.
Il s’agit donc d'une part d'un mouvement de contrôle, où la personne s’investit volontairement et librement à l’intérieur d’une démarche qui mène à l’intégration de la personne, qui lui permet de devenir véritablement elle-même, de se réaliser pleinement, de prendre en charge son existence; et d’autre part d’un mouvement de lâcher-prise, où la personne s'engage dans un processus de conversion, de transformation, qui l'amène à devenir autre, à se dépasser et à s’abandonner en Dieu.
Il s’agit également d’un processus à l’intérieur duquel la personne sort peu à peu d'une foi infantile, où tout lui est proposé ou imposé comme de l'extérieur, à la manière d’un jeune enfant; pour entrer dans une foi «enfantine», où l’adulte désormais autonome, fort d’une expérience de vie riche et empreinte de maturité intellectuelle, affective et morale, et de plus en plus apte à assumer son histoire et ses choix personnels, accepte volontairement de retrouver l’émerveillement, la fragilité, l'humilité, la dépendance et l'abandon en face d’un Dieu qu’il appelle tout simplement «Notre Père».
Une tension qui doit être maintenue.
Dernier point, sur lequel nous n’insisterons jamais assez je crois, c’est celui de la nécessité de maintenir en notre cheminement cette tension entre l’accomplissement et le dépassement de la personne. En effet, une démarche de foi qui cherche exclusivement l’abandon, la confiance et le mystère, risque de passer à côté de la réalité de l’être humain en devenir, de sombrer dans l’illusion ou la projection utopique, sans tenir compte de la réalité. De la même façon, une démarche de foi qui cherche exclusivement la réalisation de soi par la prise de contrôle de son existence et l’articulation d'une pensée, risque de négliger d’aller à la rencontre de l’altérité et du mystère de Dieu.
Pour formuler les choses autrement, nous pourrions dire que l’objectif de Dieu n’est ni la réalisation de l’être humain tel qu’il est, ni sa transformation pure et simple en «autre chose». Réalisation et dépassement sont étroitement liés à l’intérieur de l’entreprise de création, car il s’agit bien de continuer l’oeuvre de création divine. Dieu est à l’oeuvre en nous afin de parfaire sa création et de re-créer. Ainsi, pour s’engager dans la voie du dépassement, il faut déjà être engagé dans la voie de l’accomplissement. De la même façon, pour s’accomplir, il faut déjà se depasser. Mais ne réduisons pas artificiellement l’opposition, la tension, qui existe entre accomplissement et dépassement. En quelque sorte, on peut toujours affirmer que ce qui est dépassé n’est plus et que ce qui est accompli n’a plus besoin de dépassement.
La démarche de foi tient donc à des efforts qui vont dans les six directions à la fois (deux directions, deux objectifs, pour chacune des trois dimensions): l’appropriation personnelle et l'abandon, l’engagement personnel et la persévérance malgré l’incertitude, la réflexion éclairée et l’ouverture au mystère. Et si l’on tient absolument à parler d’équilibre, il nous faut savoir que celui-ci ne se trouve pas «au milieu», à l’intérieur d’un «terrain neutre», mais bien dans la quête équilibrée des «extrémes»; quête où le croyant découvre que vraie liberté et abandon véritable sont intimement liés, que la quête de sens mène finalement à un choix définitif en faveur de l’inconnu, et que la vérité la plus haute que l’on puisse exprimer à propos de Dieu s’exprime dans le silence de celui ou de celle qui contemple son mystère.
Nous sommes bien loin de la quête du «paradis perdu». Mais l’aventure est passionante et remplie de promesse.
Source: Paul-André Giguère, notes de cours, session “Devenir adulte dans la foi” Institut de Pastoralede Montréal (automne 1994). http://www.partafoi.abeditions.com. |